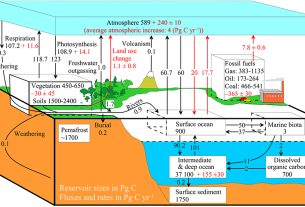Romain Goury, University of Grenoble Alpes in France, discusses his article: Recent vegetation shifts in the French Alps with winners outnumbering losers, in both English and French.
When we walk through the mountains, it is often easy to notice plants that have not been there before. But spotting those that are quietly disappearing is a much harder task. This is especially true in high-altitude ecosystems, where forests slowly creep upwards, masking the retreat of more discreet species. This was the challenge we set out to address in our study to determine which plants are truly gaining ground in the French Alps, and which ones are instead losing it.
Observing thirty years of change
To answer this question, we drew on a large dataset covering the entire French Alps over a thirty-year period. Our aim was twofold: to identify the species increasing and those declining, and to explore whether these species shared common traits – for instance, growth rate, tolerance to temperature, or even family relationships.
The task, however, was not straightforward. Unlike standardised monitoring, our data is based on observations collected with sampling strategies that have varied over the last 30 years. In other words, some areas have been visited intensively, while others have not, and each site has only been visited once. This makes it impossible to draw direct conclusions about species trends.
To account for these challenges, we used a statistical method called FRESCALO. This algorithm corrects for spatial and temporal biases by grouping data into larger geographical units. It is a key step in making meaningful comparisons of species frequency change through time.
Winners, losers… and the rest
Over the past three decades, the winners outnumber the losers. Around 31% of species increased in frequency, compared with 13% in decline. At the same time, nearly 30% of species showed changes that were more difficult to interpret, with highly variable frequencies over time.
So who are these “winners”? They are often ruderal species – plants that thrive in disturbed environments. If you drive along a mountain road towards a high pass, the grasses you see along the roadside are good examples of this profile: opportunistic species making the most of disturbance.
Another clear pattern relates to temperature. Many of the species on the rise are thermophilous, meaning they are adapted to warmer conditions. Their spread appears to reflect the impact of rising temperatures, which are particularly pronounced at high altitudes – although this was not directly tested in our study. Finally, plants with a fast growth strategy also seem to be among the winners.

What this tells us about the mountains of tomorrow
These results highlight how mountain ecosystems are undergoing deep transformations under the combined influence of climate change and human activity. Today’s winners – fast growing, disturbance-tolerant, and heat-loving species – are gradually reshaping the alpine landscapes. In contrast, other species, less competitive or living in increasingly threatened habitats, are slowly retreating.
The trends we observe today are likely to intensify in the coming decades. By understanding these trajectories now, we can not only anticipate the changes ahead but also begin to think about how best to preserve the plant diversity of our mountains, especially the diversity of plants adapted to colder, undisturbed, and high-altitude ecosystems.

Quand les plantes gagnent (ou perdent) du terrain dans les Alpes Françaises
Romain Goury, Université Grenoble Alpes (France), parle de son article: Recent vegetation shifts in the French Alps with winners outnumbering losers (Les changements récents de la végétation dans les Alpes Françaises révèlent que les gagnants sont plus nombreux que les perdants).
Lorsque nous nous promenons en montagne, il est assez facile de remarquer certaines plantes qui semblent plus présentes qu’autrefois. Mais repérer celles qui disparaissent peu à peu est souvent peine perdue. En particulier dans les écosystèmes de hautes altitudes, où la forêt s’étend discrètement vers des altitudes plus élevées, rendant invisible le recul de certaines espèces.
C’est ce challenge que nous voulions aborder dans notre étude afin de déterminer quelles plantes progressent vraiment dans les Alpes françaises, et lesquelles au contraire perdent du terrain.
Observer trente ans de changements
Pour répondre à cette question, nous avons utilisé une base de données importante couvrant l’ensemble des Alpes françaises sur une fenêtre temporelle de 30 années. L’objectif : repérer les espèces en hausse, celles en déclin, et comprendre si elles partagent certaines caractéristiques communes (par exemple leur vitesse de croissance, leur tolérance à la température ou encore leur appartenance à une même famille botanique).
Mais l’exercice n’était pas simple. Contrairement aux suivis standardisés, nos données proviennent majoritairement d’observations qui ont été récoltées avec des stratégies d’échantillonnage qui ont variées au cours des 30 dernières années. Autrement dit, certains territoires sont très bien inventoriés, d’autres beaucoup moins, et chaque site est inventorié une seule fois, ce qui empêche de tirer des tendances pour chaque espèce de manière directe.
Pour prendre en compte ces difficultés, nous avons utilisé une méthode statistique appelée FRESCALO. Cet algorithme permet de corriger les biais spatiaux et temporels en regroupant les données par zones géographiques plus larges. Une étape clé pour comparer l’évolution de la fréquence des espèces au fil du temps.
Les gagnantes, les perdantes… et les autres
Sur les trois dernières décennies, les espèces gagnantes sont plus nombreuses que les perdantes. Environ 31 % des espèces étudiées ont vu leur fréquence augmenter, contre 13 % en déclin. Néanmoins, près de 30 % des espèces montrent également des changements plus difficiles à interpréter clairement, avec de fortes variations de fréquence.
Qui sont donc ces espèces gagnantes ? Ce sont souvent des espèces rudérales, c’est-à-dire des plantes qui profitent des perturbations. Par exemple, si vous empruntez une route de montagne en direction d’un col, les espèces que vous croisez en bordure de route sont un bon exemple pour illustrer ce profil d’espèces profitant de perturbations.
Un facteur clé semble également se dégager : la température. Beaucoup d’espèces en expansion sont thermophiles, autrement dit adaptées à des conditions qui se réchauffent. Leur progression semble illustrer l’effet de l’augmentation de la température, particulièrement marquée en haute altitude, bien que ceci n’ait pas été directement mis en évidence dans notre étude. Enfin, les plantes à croissance rapide semblent aussi mieux tirer leur épingle du jeu.

Ce que cela nous dit sur les montagnes de demain
Ces résultats montrent que les écosystèmes de montagne se transforment en profondeur sous l’effet du climat et des activités humaines. Les gagnantes d’aujourd’hui – avec une croissance rapide, tolérante aux perturbations et à la chaleur – redessinent progressivement les paysages alpins. À l’inverse, certaines espèces moins compétitives ou dont leur habitat devient menacé, reculent peu à peu.
Les tendances observées aujourd’hui pourraient s’accentuer dans les décennies à venir. Comprendre dès maintenant ces trajectoires nous permet non seulement de mieux anticiper les changements, mais aussi d’imaginer comment préserver la diversité végétale de nos montagnes, en particulier la diversité des plantes adaptées aux écosystèmes plus froids, non perturbés, de haute altitude.